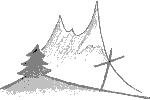- in La Cambuse n°10, avril 1999 -
Au camp du Lauzet, en 1975, l’eau du torrent était coupée au milieu de la journée. Le comité d’accueil alpin, constitué par les marmottes du Cougnet et les chamois de la crête de l’Alp Gaston, supervisé par les têtards du lac Néal, encouragé par les mouches du coche, comme toujours, présidé par un lointain choucas qui nichait dans une falaise du pic de Béal Traversier, ce comité donc avait décidé de nous priver aux chiennes d’heures — les plus chaudes du jour — de la jouissance d’une eau naguère scintillante et chantante. Sans doute le syndic ou les employés du comité ouvraient-ils des citernes secrètes en amont du lieu de camp, pour constituer de profondes réserves. Le grondement du torrent de Bouchouse se changeait en gargouillis, le gargouillis en clapotement, le clapotement en silence. Alors, nous étions seuls tous les cents.
La rivière des cailloux
Bien sûr, nous n’allions pas mourir de soif. On nous avait laissé le petit robinet de cette source délicieuse et enivrante auprès de laquelle nous avions installé la cuisine au coude de l’adret et du plan. Mais de rivière, plus. On passait à pied sec le lit qu’on avait l’intention de sauter à pieds joints. Les lézards se chauffaient sur les galets noyés la nuit. Quand on jetait un campeur au torrent, ce n’était pas une bouée qu’il fallait lui donner, mais des amortisseurs, voire, un parachute. On faisait des batailles de seaux d’eau à grands coups de seaux d’air.
Le soir, le comité d’accueil alpin, dans sa générosité, nous redonnait de l’eau, soit qu’il fermât les citernes et réservoirs susdits, soit qu’il ouvrît les vannes inconnues du torrent du Pansier, ou fît je ne sais trop quoi pour gonfler le torrent de la Pisse, les deux tributaires principaux de notre Bouchouse. La nuit, l’eau vive ressuscitée accompagnait de ses glouglous et de ses borborygmes nos discrets ronflements. Le matin, elle s’offrait dans toute sa fraîcheur pour laver la lourdeur des paupières et les macules des rêves. Moi que mon surnom obligeait à m’y rouler complètement, d’autant plus que mon imagination mythologique me faisait croire que je pressais des naïades nues sur mon sein, si le chef avait sonné un peu tard, je trouvais à peine assez d’eau pour me rincer.
Un petit val qui mousse de savon…
C’est là que le bât blesse. Voici le hic. L’eau venait à moi toute cristalline, toute limpide, toute pure, malgré en amont les ébats amoureux des truites ; elle repartait en aval souillée de notre savon et de notre dentifrice. Voilà de quoi faire naître une conscience culpabilisée et écologique ! Voilà pourquoi, peut-être, le comité d’accueil préférait ne laisser couler l’eau qu’aux heures où les campeurs ne s’en servent plus, de nuit. Après avoir subi nos sévices, le torrent cascadait, moussant un peu de pierre en pierre, vers d’autres hommes qui le buvaient, les inconscients, les pékins ! et le souillaient un peu plus ; il cascadait, cascadait, cascadait encore, et chemin faisant perdait sa vertu. À La Roche-de-Rame, il se jetait dans les eaux abondantes, mais bleu-gris, de la Durance, que l’on ne peut pas, certes, comparer au Gange, mais le principe est le même.
Devenu conscient de la dégradation hideuse que sa présence cause à la rivière innocente, le campeur transformé en écologiste réagira, et s’imposera les principes suivants. J’espère que cette publication les répandra largement : Primo, il ne faut jamais, sauf au Sahara, faire pipi (ou pire), se gratter le nez, se couper les ongles sur un alignement de cailloux : ce peut être le lit à sec d’un torrent. Deuzio, on devrait encourager les campeurs à creuser des puits en plus des gogues, mais à quelque distance... Tertio, il ne faut se laver dans un cours d’eau que lorsque l’eau est manifestement plus sale que le corps que l’on y plonge. Ainsi, l’intervention humaine nettoiera-t-elle peut-être le cours d’eau…
Remonter aux sources
L’étymologiste, quant à lui, réagit différemment. Il se félicite que la rivière qui enchante le Lauzet soit un torrent par excellence, voire par définition. En effet, l’origine de torrent, c’est le latin torrens, qui vient du verbe torreo, lequel signifie “ faire brûler ” ou “ dessécher ”. Par suite torrens, adjectivé, signifie “ brûlant ”, “ desséché ”. Paradoxalement, le torrent, c’est ce qui brûle. Ne le disais-je pas dans l’Étymologie précédente (La Cambuse n°9) ? Ou bien, le torrent, c’est ce qui est desséché, et donc le ruisseau du Lauzet ne mérite vraiment son nom que lorsqu’il est à sec au milieu torride du jour.
Pour ma part, quand il s’agit de torrent, je procède en étymologiste d’une autre manière. Pour un cours d’eau, sa racine, c’est sa source. J’aime remonter à la source des torrents. D’autres, qui font fi de la parole de Gide selon laquelle “ il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant ”, préfèrent la descente, et pratiquent le canyoning. Or toute descente s’accompagne d’une perte, d’une entropie : l’air est moins pur, l’eau est moins limpide, la nature moins sauvage ; le torrent se jette dans la grande rivière grise après avoir fait quelques coudes entre des décharges diverses et récupéré les eaux usées du village. De plus, le trajet vers l’aval est généralement unique. C’est tout le contraire pour la recherche des sources : l’ingénuité de l’eau est plus grande, sa saveur plus diverse, et il y a cent filets d’eau distincts à découvrir.
Une fois de plus, on constatera que je préfère avec Gide, encore, “ boire à toutes les sources ”, et avec Baudelaire, recueillir en amont “ tout vestige ” du “ passé lumineux ”, plutôt que suivre à vau-l’eau le cours unique d’un avenir de mauvaise embouchure…
P.S. : À propos de “ mal embouché ”, je renouvelle et claironne mon appel à l’aide : qui voudra éclairer ma lanterne sur l’origine du terme “ gudu ” ?…
Bernard Berthier, alias Castor, moniteur de 1970 à 1977
|
De torrente in via bibet propterea exaltabit caput : En chemin il boira au torrent ; alors il relèvera la tête. Psaume CX, 7 |